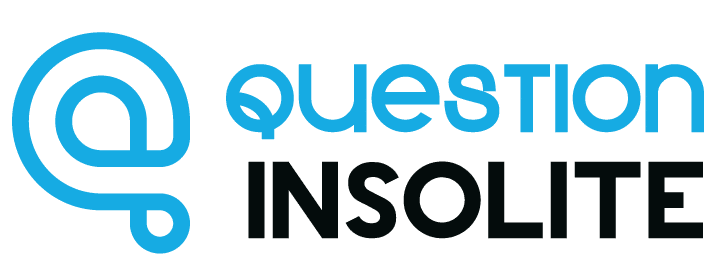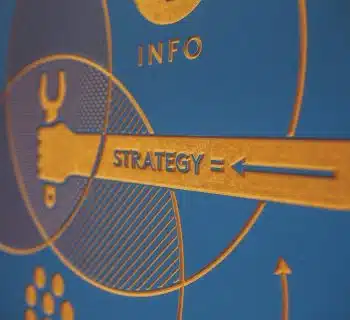La maison partagée, une alternative de logement, gagne en popularité. Ce modèle repose sur le principe de cohabiter dans un même espace tout en préservant des zones privées pour chaque résident. Les habitants partagent les espaces communs comme la cuisine, le salon et parfois même les tâches ménagères.
Parmi les avantages, on note une réduction significative des coûts de vie grâce au partage des charges et des loyers. Ce mode de vie favorise aussi les interactions sociales et peut créer un véritable sentiment de communauté. Il séduit particulièrement les jeunes professionnels, les étudiants et les personnes âgées cherchant à rompre l'isolement.
A voir aussi : Avantages de l'hypothèque : pourquoi opter pour ce financement ?
Plan de l'article
Qu'est-ce qu'une maison partagée ?
La maison partagée est un modèle d'habitat inclusif et participatif destiné principalement aux personnes âgées. Elle constitue une alternative aux EHPAD et au maintien à domicile. Ce type de logement accueille généralement entre 5 et 10 résidents, permettant ainsi de créer un environnement à taille humaine. Situées à proximité des services de transport en commun, des commerces et des services municipaux, ces maisons favorisent l'autonomie des habitants.
Les maisons partagées peuvent appartenir à la fois au parc privé et au parc social. Les résidents ont la possibilité d'être locataires, colocataires ou propriétaires. Ce modèle non médicalisé convient particulièrement aux personnes âgées qui ont conservé leur autonomie.
A lire en complément : Les meilleures stratégies de financement pour valoriser votre bien immobilier grâce à des travaux de rénovation
- Les maisons partagées accueillent entre 5 et 10 personnes âgées en moyenne.
- Les maisons partagées sont situées à proximité des services de transport en commun, des commerces et des services municipaux.
- Les maisons partagées peuvent appartenir au parc privé ou au parc social.
- Les habitants peuvent être locataires, colocataires ou propriétaires.
- Les maisons partagées ne sont pas médicalisées.
- Les maisons partagées conviennent particulièrement aux personnes âgées qui ont conservé leur autonomie.
Ce modèle d'habitat offre une vie sociale riche et permet de rompre l'isolement souvent ressenti par les personnes âgées. En intégrant un projet de vie sociale commun, les résidents peuvent participer à diverses activités et maintenir des liens sociaux forts. L'immo maison partagée devient ainsi une solution attrayante pour ceux qui cherchent une alternative conviviale et solidaire à l'habitat traditionnel.
Comment fonctionne une maison partagée ?
Le fonctionnement d'une maison partagée repose sur un modèle collaboratif et une organisation collective. Les résidents partagent des espaces communs tels que la cuisine, le salon et parfois le jardin, tout en disposant de chambres individuelles. Cette configuration permet à chacun de bénéficier d'un équilibre entre vie privée et moments de convivialité.
Services et accompagnement
Les maisons partagées peuvent faire appel à divers services d'accompagnement pour répondre aux besoins des résidents. Parmi eux :
- Auxiliaires de vie : ces professionnels aident les résidents dans les actes de la vie quotidienne.
- Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : ils interviennent pour des soins médicaux ponctuels ou réguliers.
Certaines maisons partagées sont aussi proposées par des organismes spécialisés comme CetteFamille, qui se charge de leur gestion et de la coordination des services.
Organisation de la vie quotidienne
La vie quotidienne s'organise autour de tâches partagées et de règles de vie commune définies par les résidents eux-mêmes. Les décisions sont prises en assemblée, favorisant ainsi une démocratie participative.
| Aspect | Fonctionnement |
|---|---|
| Espaces communs | Partagés et entretenus collectivement |
| Services | Auxiliaires de vie, SSIAD |
| Décisions | Prises en assemblée |
Ce mode de vie permet de créer une dynamique de groupe et de renforcer les liens sociaux entre les résidents, tout en leur offrant un cadre de vie sécurisé et adapté à leurs besoins.
Les avantages de la maison partagée
Les maisons partagées offrent de nombreux avantages économiques et sociaux. En mutualisant les coûts liés au logement, elles permettent de réaliser des économies importantes. Les charges sont divisées entre les résidents, réduisant ainsi les dépenses individuelles.
Ce mode de vie favorise aussi la rupture avec la solitude. Vivre en maison partagée permet de créer des liens sociaux solides et de participer à une vie communautaire active. Les résidents partagent des moments de convivialité, organisent des activités communes et se soutiennent mutuellement.
Un autre avantage réside dans le fait que les maisons partagées sont situées à proximité des services de transport en commun, des commerces et des services municipaux. Cette proximité facilite l'accès aux commodités et aux soins nécessaires, tout en permettant aux résidents de maintenir un lien avec la société.
Les maisons partagées rassurent aussi l'entourage familial. Savoir que leur proche vit dans un environnement sécurisé, entouré de personnes bienveillantes, est une source de tranquillité d'esprit pour les familles.
Ce type d’habitat permet aux personnes âgées d’accéder aux mêmes droits que pour tout autre projet de location. Les résidents peuvent être locataires, colocataires ou propriétaires, selon les modalités définies par la maison partagée.
La maison partagée représente une alternative intéressante aux EHPAD et au maintien à domicile, offrant un cadre de vie convivial, sécurisé et économiquement avantageux pour les personnes âgées.
Les aides financières pour une maison partagée
Les maisons partagées peuvent bénéficier de diverses aides financières pour alléger le coût de la vie en communauté. Parmi celles-ci, l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) est destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie. Elle permet de payer les dépenses nécessaires pour vivre en maison partagée, comme les prestations d’aide à domicile, le matériel médical et les aménagements du logement.
L'aide personnalisée au logement (APL) et l'allocation de logement social (ALS), toutes deux délivrées par la CAF, sont aussi disponibles. L’APL est calculée en fonction des ressources de la personne âgée et du loyer de la maison partagée, tandis que l’ALS peut être versée au locataire ou directement au propriétaire. Ces aides sont majeures pour rendre le logement accessible aux résidents.
Une autre aide, l'aide à la vie partagée (AVP), vise à accélérer le déploiement des maisons partagées sur le territoire français. Octroyée à tout habitant d’un habitat inclusif dont le porteur de projet a passé une convention avec le département, l’AVP est directement versée par le conseil départemental à la personne morale responsable de l’habitat conventionné API. Cette aide finance notamment l’animation et la coordination du projet de vie sociale.